
Dans le cadre du projet Life Marha (Marine habitats), [1]piloté par l’Office Français de la Biodiversité (OFB), le Pôle-relais lagunes méditerranéennes accompagne les animateurs et gestionnaires de sites N2000 dans l’évaluation de l’état de conservation de l’habitat 1150 « Lagunes méditerranéennes » avec la méthode parue en 2019 [2] et le classeur de fiches techniques paru fin 2020 [3] en appui à la mise en œuvre opérationnelle.
Cette formation s’inscrit dans cet accompagnement sur deux des 12 indicateurs de la méthode : l’indicateur « Surface des herbiers » et l’indicateur « Macrophytes » qui s’intéresse à l’abondance et la composition des herbiers de plantes hydrophytes.
L’objectif était de s’initier à l’identification des principales espèces d’hydrophytes constitutives des herbiers des milieux lagunaires et d’analyser la composition de leurs peuplements.
Les 8 gestionnaires de lagunes et animateurs N2000 de sept structures différentes ont participé à ces deux journées qui ont eu lieu le 29 et 30 avril dernier à la Tour du Valat avec l’appui de Nicolas Borel (consultant).
Cette cinquième session de formation répond aux besoins des gestionnaires de mieux identifier les hydrophytes des milieux saumâtres à dessalés et mettre ainsi en place le suivi de cet indicateur sur leurs lagunes. En effet, le maintien ou le développement des herbiers d’hydrophytes dans les lagunes constitue un enjeu majeur pour la conservation de ces milieux, en raison du rôle clé qu’ils jouent dans le fonctionnement du milieu : production d’oxygène, participation au métabolisme des nutriments azotés et phosphorés, amélioration de la transparence de l’eau, stabilisation des facteurs physico-chimiques, comme le pH.
De fortes pluies hivernales et printanières…
Les fortes précipitations survenues durant l’hiver et le printemps ont entraîné une montée importante des niveaux d’eau, favorisant ainsi l’expression de la banque de graines. La végétation s’est révélée plus facilement observable, et les plantes devraient produire une grande quantité de graines, contribuant à la reconstitution de banques de graines solides pour les années à venir.
La première journée de terrain a permis la reconnaissance de divers types de lagunes, notamment des systèmes lagunaires permanents marinisés, temporaires salés et saumâtres.


Grâce à l’accompagnement de Marc Thibault (Chef de projet Gestion et restauration de zones humides à la Tour du Valat) nous avons pu visiter les lagunes des étangs et marais des salins de Camargue (EMSC) au sud-est du delta du Rhône au milieu des ambiances marines, lagunaires et des grandes étendues dunaires et sableuses où un projet de restauration compte restituer les échanges spontanés entre la mer et les étangs.
Dans les lagunes temporaires salées, de magnifiques herbiers de Althenia filiformis, Ruppia maritima et Lamprothamnium papulosum (une characée dont les rameaux fertiles forment un épi en « queue de renard ») ont attiré notre attention. En progressant lentement vers la mer, nous avons également observé dans les lagunes permanentes salées : Zoostera noltei, Ruppia cirrhosa et différentes espèces d’algues vertes marines (Ulva rigida, U. clathrata, U. monostroma) et rouges (Polysiphonia elongata et Gracilaria).
Un amas de spaghetti enroulé sur lui-même, de couleur orange, rose déposé sur les algues a attiré notre attention. Il s’agissait vraisemblablement de la ponte constituée de milliers d’œufs regroupés d’un mollusque opistobranche : Aplysia punctata.
Dans une autre lagune saumâtre temporaire située sur un site différent, nous avons découvert Riella helicophylla, une mousse endémique du bassin méditerranéen et Tolypella une algue à forte valeur patrimoniale appartenant à un groupe d’algues complexe et encore peu étudié : les Characées.


Du terrain à la loupe
La deuxième journée a été consacrée à l’identification des échantillons de macrophytes amenées par les gestionnaires et l’intervenant.
Grâce à l’utilisation de divers guides d’identification des macrophytes, aux recommandations du formateur et à une observation attentive à la loupe binoculaire, le groupe a pu identifier les différents échantillons. L’identification des algues a nécessité l’usage du microscope, mais cet exercice s’est révélé complexe en l’absence d’un algologue. En effet, les spécialistes des algues se font de plus en plus rares.
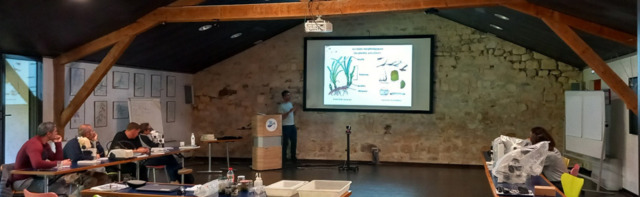
Conclusions
Les participants ont exprimé une grande satisfaction à l’issue de ces deux jours de formation. Ils ont particulièrement salué la qualité des sites visités, la diversité des lagunes explorées, l’application pratique des acquis, ainsi que la pédagogie et l’expertise de l’intervenant, autant d’éléments soulignés dans leurs évaluations.
Le Pôle-relais lagunes méditerranéennes remercie encore Nicolas Borel pour la qualité de son intervention et Marc Thibault pour son accompagnement sur le site des EMSC et ses explications. Il remercie également les gestionnaires pour leur participation active à ces journées.
- Contact
Katia Lombardini [email protected] [4],
Chargée de mission PACA du Pôle-relais lagunes méditerranéennes, Tour du Valat
Crédits photos : Pôle lagunes